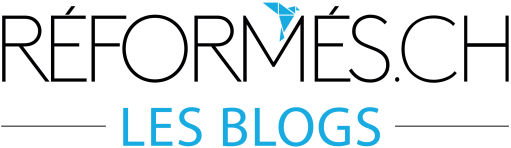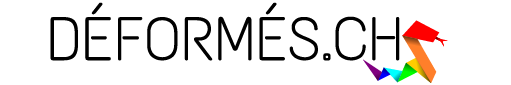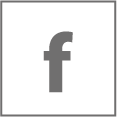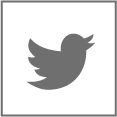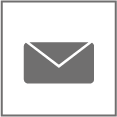Anne Nivat: «Je suis une éponge qui restitue ce qu’elle absorbe»
Vous connaissez particulièrement bien Genève, votre père ayant dirigé le département de slavistique de l’Université.
Oui, et j’aime cette ville. J’ai grandi juste de l’autre côté du Salève. Mes parents sont encore dans la maison qu’ils ont fait construire en 1974, cinq ans après ma naissance. Je vis désormais à Paris, mais ce n’est qu’une base. Toute ma vie est dédiée à d’autres endroits.
Vous passez une partie de votre temps dans les Cévennes, un autre lieu protestant, vous qui êtes de religion réformée…
Ce ne sont que des coïncidences. Mon mari (ndlr: le journaliste Jean-Jacques Bourdin), qui est lui aussi protestant, est originaire de cette belle région. Je ne suis pas pratiquante, mais j’ai un immense respect pour toutes les religions. En Irak, j’ai pour très bon ami un frère dominicain. Un homme exceptionnel, un héros parce qu’il reste sur place alors qu’il aurait pu partir comme beaucoup de chrétiens pourchassés, qui ont une vie terrible. Je trouve cette résistance-là merveilleuse.
Vous connaissez bien l’islam, que vous côtoyez dans tous vos reportages.
Je connais parfois mieux le Coran que certains interlocuteurs musulmans qui me débitent souvent des espèces d’idioties apprises par cœur. Il y a mille et une façons de pratiquer cette religion. J’ai vu des mosquées qui étaient des havres de paix, des endroits merveilleux où l’on peut dormir et se ressourcer. Comme j’ai vu des mosquées devenues le centre de violences, dans lesquelles il y a des caches d’armes. C’est l’instrumentalisation des lieux de prière par la guerre.
Vous êtes devenue correspondante de guerre par hasard, parce que vous étiez en Tchétchénie lorsque les combats ont commencé. Pourquoi avoir continué dans cette voie?
C’est tout simplement la vie que j’ai choisie. Ce qui m’intéresse, c’est de faire ce que j’aime: aller sur le terrain puis partager ce que j’ai observé. Il se trouve que j’ai commencé dans un pays en guerre et qu’ensuite il y a eu le drame du 11 septembre 2001, qui m’a donné l’envie et la curiosité d’aller en Afghanistan et en Irak.
Douze ans plus tard, vous y retournez toujours...
La situation, toujours instable, ne mérite pas que je m’en désintéresse. Je persévère sur une lancée, je ne papillonne pas en sautant d’une guerre à l’autre. Je n’ai pas le temps de faire toutes les enquêtes que je voudrais, mais je me dois de continuer celles qui sont en cours.
Dans votre dernier livre*, vous avez enquêté sur le Birobidjan, une région en paix!
Au lendemain de la révolution bolchevique, bien avant la création d'Israël, Staline a créé une entité territoriale pour les juifs en URSS: le Birobidjan, à la frontière chinoise. Cette espèce de confetti subsiste aujourd’hui encore. Cette région m’a intéressée parce que j’habitais en Russie, de la même façon que la Tchétchénie m’a touchée. Le fait que cette entité existe toujours, alors que tant d’années ont passé, est un très bon sujet d’enquête.
Etes-vous plus intéressée par les sujets que les autres délaissent?
L’actualité et ce que font les autres ne déterminent pas mon action. Je poursuis mes propres intérêts, qui sont toujours les mêmes : raconter des histoires humaines et universelles. Que ce soient des drames ou des histoires heureuses. Ce livre du Birobidjan, comme ceux sur l’Irak, l’Afghanistan ou la Tchétchénie, ce sont des histoires de familles, d’individus, de départs, de retours, d’espoirs et de déceptions. C’est tout simplement la vie des gens, des pans qu’il m’a été donné d’observer et que je relate.
Pourquoi, après plusieurs livres, avoir récemment réalisé un film, «Irak: l’ombre de la guerre»?
Je pressens l’importance de l’image. Je me suis dit que c’était possible étant donné mon niveau d’infiltration de l’Irak. Qu’il fallait en profiter pour que l’on voie des Irakiens et qu’on les entende. Cela ne veut pas dire que j’abandonne l’écrit. Ce n’est qu’un autre instrument pour raconter différemment la même histoire.
Avoir réussi à le faire en Irak est le fruit de contacts entretenus depuis de nombreuses années, au fil de multiples voyages…
Oui, bien sûr. Les autres films sur l’Irak ne montrent pas ce qui me semble intéressant : l’humanité. Les voix singulières que je mets en avant n’ont aucune prétention à l’exhaustivité, mais disent des choses que je voudrais qu’ici, en Occident, on entende. Elles nous rapprochent des Irakiens, sur lesquels les gens d’ici n’ont pas la moindre idée parce qu’on ne les a pas vraiment vus pendant dix ans, au contraire des colonnes de tanks et des militaires.
Vous dites être une éponge qui restitue ce qu’elle a absorbé.
Je ne suis qu’un intermédiaire, je redirige ce qu’on me dit. Je veux mettre sans cesse en avant la parole des habitants. Je pense que les gens ne sont ni indifférents, ni lassés de ces histoires qui se passent très loin de chez eux, contrairement à ce que les médias veulent bien nous faire croire.
D’où vous vient cet intérêt pour les gens ?
Je trouve que tout le monde a quelque chose à dire. Je m’intéresse autant à quelqu’un qui n’est personne qu’à un président. Essayer de comprendre ce que les gens ont dans la tête permet de mieux appréhender la situation, le contexte, et de les faire partager. Mon but est d’apporter quelque chose à l’édifice, même si c’est infime.
Avez-vous aussi le fol espoir de rapprocher les gens?
Sans doute ! Il y a, finalement, un côté très optimiste de la nature humaine. Même si l’on n’est pas d’accord avec ce que dit l’autre, il faut l’entendre. Ecouter ne veut pas dire accepter. Je me suis souvent trouvée en face de djihadistes et d’extrémistes qui n’avaient pas du tout les mêmes valeurs et les mêmes jugements sur les choses que moi. Mais si je ne veux pas écouter ce qu’ils disent et que je ne leur pose pas de questions, comment pourrais-je comprendre ce qu’ils pensent, réfléchir à la situation, à leur danger potentiel ou à leur absence de danger? Il faut cogiter et débattre ensemble plutôt que se précipiter dans des guerres, ce qui a été le cas des deux dernières grandes guerres : l’Irak et l’Afghanistan. Ce sont des gâchis monumentaux. Même les militaires me le disent. Eux qui ont combattu se rendent compte, bien plus que les politiques, que ces guerres ont été mal engagées.
Est-ce pour être plus en sécurité que vous dormez chez l’habitant, voyagez avec les moyens locaux et vous habillez comme les femmes du pays?
Cela permet une confiance immédiate et minimise les risques. Se fondre dans la masse permet d’être protégée. Si l’on est différent, d’une façon extérieure, on peut être pris pour cible.
Le fait d’être journaliste fait-il aussi de vous une cible?
C’est d’être dans un pays en guerre qui fait qu’on est une cible. Tout y est différent, les rapports humains ne sont pas du tout les mêmes. Il faut être sur ses gardes en permanence. Un journaliste est partout un intrus et un gêneur. Mais dans un pays en guerre, il y a plus de possibilités que cela mène au pire, puisqu’il y a des armes partout.
Vous prenez votre temps, un luxe?
Avant, je pouvais partir 3-4 mois d’affilée. Je peux me permettre de m’en aller moins longtemps aujourd’hui parce que je vais dans des endroits que je connais de mieux en mieux. Le temps, c’est capital. C’est ne pas se précipiter, ne pas s’impatienter. Parce que, sinon, on a forcément de faux jugements.
Parlez-vous l’arabe? Parce que parler la langue du pays permet souvent un rapport différent avec les gens.
J’apprends l’arabe littéraire pour lire les journaux, mais pas le dialectal. Cependant, nous avons une langue commune avec beaucoup d’interlocuteurs, généralement l’anglais, mais cela peut aussi être le russe. Ce qui importe, c’est de ne pas être avec un interprète. Une autre personne complique tout, il y a moins de confiance. Instaurer la confiance, c’est la clé. Cela va avec le temps passé et le fait d’être sur le terrain. Quand quelqu’un vous rencontre sur son terrain, vous partez avec un sacré avantage. Vous vous êtes mis au même niveau que lui, il n’y a pas de différence entre vous. Parce que, sinon, il y a beaucoup de méfiance.
Parce que, quand on dit pays arabes, certains amalgames se font?
L’amalgame musulman = islamiste = terroriste, on n’y coupe pas. Il est dans la tête de tout le monde depuis le 11 septembre 2001. Je combats ces stéréotypes, mais il y en a de plus en plus. On n’arrive plus à voir les choses avec distance et nuances. On est dans le jugement permanent et hâtif. J’aimerais qu’on ne se contente pas du regard qui est le nôtre: occidentalo-centré. Que les gens se disent que peut-être les Irakiens, les Afghans et les Tchétchènes n’ont pas la même vision sur ces conflits que nous.
Y a-t-il des raisons d’être optimiste?
Si on se place au niveau individu à individu, alors oui. Parce que sinon, je n’aurais jamais réussi à faire ce que j’ai fait. Même dans un terrain hostile, en temps de guerre, face à des gens que l’on nous présente comme nos ennemis, quelqu’un d’occidental peut être bien accueilli. C’est quand même une belle leçon! Cela montre que le dialogue est toujours possible.
*La République juive de Staline. Editions Fayard, 366 pages.