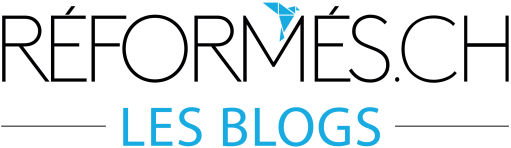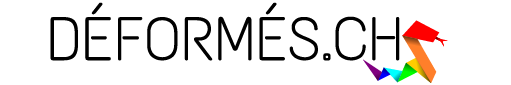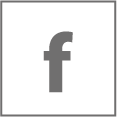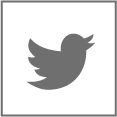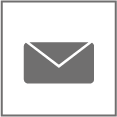"Tant qu’il pleut en Amérique..."
Votre film «Tant qu’il pleut en Amérique» a fait cette semaine un passage remarqué à Visions du Réel. D’où vous est venue l’idée de réaliser un film sur l’Ethiopie?
La musique de «We are the world résonne encore à nos oreilles à tous. C’était l’opération humanitaire la plus vaste jamais lancée. Trente ans plus tard, le pays est loin de se résumer à cette réalité, mais l’image de l’enfant affamé cerné par le désert, continue d’imprégner notre imaginaire. Puis je suis tombé sur l’ouvrage de Jean Ziegler «L’empire de la honte», où j’ai appris qu’on produisait en Ethiopie l’un des meilleurs cafés du monde.
Ces cultures sont des sources de profits colossaux pour certaines multinationales comme Starbucks, mais ne parviennent pourtant pas à faire vivre décemment leurs producteurs. Beaucoup préfèrent convertir leurs plantations de café en culture de khat (ndlr: sorte d’amphétamine naturelle très prisée dans cette région de la corne de l’Afrique).
Il s’agit davantage d’un road movie que d’une enquête. Le film est structuré par les portraits des personnes rencontrées dans les différentes parties du pays.
Le problème des paysans africains a déjà été traité mille fois et je n’ai pas vocation d’être un investigateur. L’Ethiopie est un pays tellement surprenant dont on connaît si peu. Notre vision se réduit à quelques aspects tels que la famine, les guerres ou les coureurs de marathon… Arrivé sur place, j’ai été très frappé par d'autres réalités et ma priorité a été de les rendre visibles.
Tout en dénonçant clairement certaines réalités?
Oui, je suis partisan d’un cinéma engagé. Ce cercle vicieux qui consiste à «échanger» de l’aide alimentaire contre des matières premières, plutôt qu’à payer celles-ci au prix juste, entraîne le pays dans une spirale infernale dont on ne voit pas la sortie. Mais je me suis refusé à faire intervenir des experts - hormis le vieux professeur d’agronomie éthiopien qui livre ses analyses – mais il est davantage traité comme un personnage, dans sa dimension humaine, que comme spécialiste.
On entre dans le film par une voix de radio et la bande son y tient aussi une place importante?
C’est le jazz-funk éthiopien qui nous accompagne tout le long du film, une musique produite dans les années septante, que le film «Broken flowers» de Jim Jarmush a permis de redécouvrir. J’ai aussi bénéficié de la collaboration de Carlos Leal pour la voix off, que je trouve très réussie.
Comment le film a-t-il été accueilli par le public de Nyon
Bien. Il y a eu beaucoup de questions (rires), ce qui est un des buts du film!
Où pourra-t-on voir le film?
Dans les open air cet été et sa sortie en salle est prévue à la rentrée
Que signifie pour vous d’être sélectionné à Visions du Réel?
C’est la troisième fois qu’un de mes films passe dans la section Helvétique et c’est toujours un bonheur. Nyon est pour moi un peu comme une école, où je venais chaque année faire mes classes lors de ma formation.
Certains disent que les documentaires suisses sont trop nombreux sur nos écrans. Qu’en dites-vous?
Il y a une vraie culture du documentaire en Suisse, héritée notamment de la télévision; nous avons tous bénéficié de cet héritage. Il y a peu d’argent pour financer le cinéma suisse et le documentaire coûte peu en comparaison. C’est aussi une réponse…
*Né en 1973 à Genève, le réalisateur autodidacte Frédéric Baillif est l’auteur de plusieurs documentaires, à découvrir sur www.freshprod.com