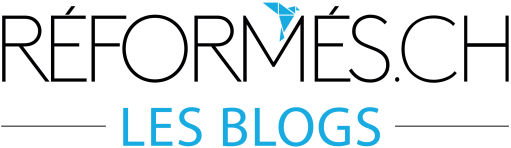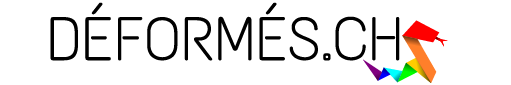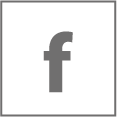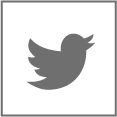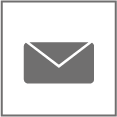Le confinement global : un nouveau seuil de prise de conscience sanitaire ?
La notion de traumatisme collectif s’applique à des populations touchées par la guerre, et a été développée depuis les années 1970. Peut-on parler de traumatisme collectif face aux 174'000 morts (au moins) du Covid-19?
Stéphane Tison: Je pense qu’il est encore un peu tôt pour le savoir. Que cette expérience, dans l’immédiat, constitue une rupture distinguant un avant et un après, oui, cela se dessine dans l’expérience inédite du confinement généralisé. Elle peut individuellement, parce qu’elle renvoie chacun·e à sa propre mort, susciter des troubles pour certaines personnes, en réveillant éventuellement des traumas plus anciens.
Pour parler de traumatisme collectif, il faut que soient réunies plusieurs conditions: qu’une personne ait une expérience d’approche directe et réelle de la mort (pour elle-même, des proches ou par le soin prodigué aux malades qui décèdent). Dès lors, pour qu’il y ait trauma collectif, il faudrait qu’une part notable de la population soit confrontée à cette situation. Cette dimension peut être réelle dans quelques régions plus particulièrement touchées par la pandémie, à Bergame ou à Mulhouse par exemple. Toutefois, et fort heureusement, le deuil n’est pas à ce stade une expérience de masse qui touche l’ensemble d’une société.
Faudra-t-il organiser des commémorations nationales pour tous les décès, comme l’a fait la Chine, par exemple ?
L’organisation d’une commémoration n’est pas exclue, si les gouvernements souhaitent à la fois inscrire durablement dans le temps l’hommage aux soignants et le souvenir des victimes de la pandémie.
Ce serait assez nouveau, car les témoignages commémoratifs mis en œuvre lors des pandémies antérieures sont extrêmement rares. Si l’on prend l’exemple des pandémies de choléra, de variole au XIXe siècle, de la grippe espagnole (A/H1N1) en 1918-1919, aucune cérémonie n’a jamais été durablement instaurée.
Quant aux monuments érigés en mémoire des victimes de ces pandémies, ils sont également fort rares, inscrits au XIXe siècle dans une dimension religieuse. Pour la grippe espagnole, ceux-ci sont rarissimes: quelques exemples au Canada, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, souvent en reconnaissance aux soignants (comme Margaret Cruickshank à Waimate en Nouvelle-Zélande, ou les infirmières de Raleigh en Caroline du Nord). De tels monuments n’ont été mis en œuvre que dans les États qui à l’époque n’avaient pas subi des pertes humaines trop élevées du fait de la Grande Guerre.
Il est clair que dans les États en guerre en Europe, la mémoire des morts de la grippe espagnole a été occultée par celle des combattants tombés sur le champ de bataille. La reconnaissance de ces victimes semble très récente et s’est effectuée dans la même logique, comme l’attestent les inaugurations de monuments et plaques lors du centenaire de la pandémie: à Victoriaville et Regina au Canada, à Wellington en Nouvelle-Zélande, à Central Vermont aux États-Unis. Si des monuments rappelant l’actuelle pandémie sont érigés, il est probable qu’ils le soient principalement dans les régions dont les populations auront subi le plus de mortalité.
Peut-on parler comme le fait l’historien Stéphane Audoin-Rouzeau de transgression anthropologique majeure dans la manière de traiter les défunts (rites funéraires à minima…) ?
Le fait d’isoler les malades, de ne plus accompagner les mourants, de réduire à leur stricte expression l’accomplissement de rites funéraires élémentaires constitue en effet une « transgression anthropologique majeure ». C’est une pratique que l’on observe couramment lors des pandémies, en 1832 (choléra) comme en 1918-1919 (grippe dite « espagnole »). Les inhumations de masse, avec une ritualisation limitée à sa stricte expression sont déjà appliquées pour des raisons d’hygiène et sanitaires. On peut dès lors considérer que cette transgression anthropologique est indissociable d’une situation de pandémie.
Du point de vue anthropologique, elle marque clairement la distinction entre sain et malsain, vie et mort, distinguant nettement des ères dangereuses et protégées. Elle peut accroître d’autant la difficulté du travail du deuil, dans la mesure où l’étape de la réalisation du décès n’est pas effectuée et dès lors reste difficile à symboliser.
Cette transgression aura-t-elle des conséquences d’autant plus délétères qu’elle intervient dans des sociétés où la mort a été déniée depuis les années 1950-1960 ? Tout dépend, je pense, de la façon dont les individus vont effectuer leur travail de deuil. Les travaux récents de Gaëlle Clavandier montrent qu’après une période de «jachère» au cours de laquelle les rites funéraires sont devenus minimalistes, notamment les rites collectifs, apparaissent depuis une vingtaine d’années des «micro-rituels» individualisés, intimisés qui redéfinissent le rapport des endeuillés à la séparation et l’absence.
En quoi cette pandémie marque-t-elle, du point de vue de l’historien, un moment inédit ?
Il faut souligner une autre rupture historique majeure : pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, la cessation momentanée de toutes les activités est mise en œuvre à une échelle géographique inédite et quelles que soient les structures des sociétés concernées.
Nous assistons au passage d’un nouveau seuil de prise de conscience sanitaire qui me semble constituer aussi une rupture anthropologique majeure. De fait, la sauvegarde des personnes fragiles est définie comme supérieure à celle des activités et des profits, et cela non pas sur un espace réduit, mais sur l’ensemble de territoires, non sans débats et résistances comme on le voit au Brésil et aux États-Unis.
Et parfois au risque de la survie d’autres populations dans les pays émergents. Plus de la moitié de la population mondiale est désormais inscrite dans cette stratégie sanitaire de prévention. C’est inédit ! Aucune décision similaire n’avait pas été mise en œuvre, ni en 1918-1919 bien entendu, ni lors des dernières pandémies de la grippe asiatique (A/H2N2) (1956-1958) et de la grippe de Hong-kong (A/H3N2) (1968-1970) qui ont causé à l’échelle mondiale le décès de 1 à 2 millions de personnes et qui étaient passées largement inaperçues.
Comment expliquez-vous cette différence de réponse ?
La veille des laboratoires mise en œuvre depuis les années 1960 à la suite de la grippe asiatique, la mise en cohérence des stratégies, suivant vaille que vaille les avis de l’OMS, la mise en débat de la recherche scientifique internationale en un temps record, montrent une progressive structuration d’une réponse à l’échelle planétaire.
Même si l’instrumentalisation politique de la pandémie demeure, même si la réponse est souvent adaptée nationalement, même si l’on observe une absence de leadership collectif dans la gestion de la pandémie, nos sociétés ont franchi un nouveau seuil face à la tragédie, celui de l’adaptation en temps réel (faute de l’avoir prévenue) et de la résilience, dans le sens littéral du terme (la mise en capacité d’un matériau à supporter une tension pour reprendre autant que possible sa forme originelle). Le choix du terme par le président Emmanuel Macron n’est pas anodin. (NDLR En France, «résilience» est le terme choisi par le chef de l’État pour les opérations militaires engagées contre le Covid-19).
Que révèle pour vous ce terme de «résilience»?
Ce qui est particulièrement intéressant, c’est que ce concept, plutôt utilisé en psychologie, l’est ici de façon plus globale. Il désigne une opération de logistique sanitaire, mais il concerne également la stratégie économique de maintien de l’emploi et de filet de sécurité pour les activités économiques. Pour l’heure, il est impossible de savoir si l’ensemble des décisions prises en ce sens, à l’échelle nationale comme internationale, n’empêcheront pas finalement la diffusion du virus, notamment lors d’une deuxième vague, ou l’effondrement à moyen terme des économies et les convulsions sociales si la crise devait s’installer durablement, faute de thérapie ou de vaccin. Pour autant, pour la première fois dans l’histoire, les sociétés humaines fondent très généralement leur réponse sur la théorie des germes, qui explique le choix unanime du confinement, certes de façon désordonnée, et non sans quelques résistances. Ces dernières sont incarnées par les bravades de Jair Bolsonaro et les réponses clivées et clivantes de Donald Trump. Mais ne faut-il pas voir dans le refus des gouverneurs aux États-Unis comme au Brésil et le respect relativement généralisé des gestes de distanciation sociale un désaveu ?
Globalement, nos sociétés auront tenté d’empêcher, au risque de saper leurs fondations économiques, un épisode tragique de leur histoire. La vie aura eu, momentanément, plus d’importance que la recherche du profit. Après cette crise, restera à reconquérir les libertés fondamentales, notamment dans les États où ce nouveau seuil de sécurité sanitaire rime avec la tentation de dérive sécuritaire…
En savoir plus
Stéphane Tison est maître de conférences en histoire contemporaine à l’Université du Mans, chercheur au laboratoire TEMOS (Temps, mondes et sociétés/UMRS CNRS 9016). Il étudie la trace des conflits dans la société française et les milieux militaires et a publié de nombreux articles sur le traumatisme de guerre et la commémoration des guerres de 1870-1871 et 1914-1918. Parmi ses ouvrages, «Du front à l’asile» étudie les vies des personnes souffrant de troubles psychiatriques après la Première Guerre mondiale, et « Un siècle de sites funéraires de la Grande Guerre », étudie l’individualisation des sépultures dans le contexte de la mort de masse au cours de ce conflit.