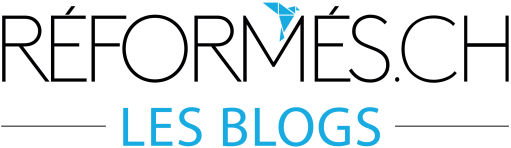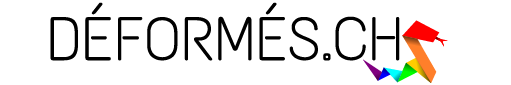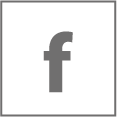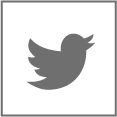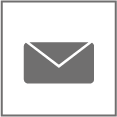Ce que Ramuz, Chappaz et Chessex doivent à la Bible
«Réserve d’images, de fables, de figures ou de préceptes», la Bible a été, au cours du XXe siècle, un foisonnant abreuvoir pour les écrivains romands. Bien que majoritairement agnostiques, les auteurs de Suisse romande n’ont pas fait l’impasse sur les deux Testaments et ce que ces derniers ont injecté dans leur chair et dans leur langue. Au point d’y faire largement référence, du «Pasteur Burg» d’un Jacques Chessex fier de ses initiales christiques, au «Match Valais-Judée» de Maurice Chappaz, qui compare la plaine du Rhône avec la Terre promise, en passant par les romans apocalyptiques de Charles Ferdinand Ramuz et l’audacieux projet de Catherine Colomb de «récrire la Bible».
Dans «Au commencement était le verbe», la professeure de littérature francophone et auteure Sylviane Dupuis cartographie le rapport au Livre de nos écrivains. Un essai qui se veut littéraire, pas théologique, où l’universitaire genevoise explique pourquoi et comment l’espace littéraire romand, au siècle dernier, témoigne d’un mouvement allant «des Écritures à l’écriture». Interview.
Pourquoi la littérature romande, à l’inverse de la littérature moderne française, ne se distancie-t-elle pas de la Bible?
En France, le surréalisme et les avant-gardes ont changé la donne; on assiste à une forme de rejet de la Bible, voire de la religion elle-même, dans la littérature. Il faut évidemment rappeler que du côté français se conjuguent, dès la fin du XVIIIe siècle, la Révolution et déjà un postulat de laïcité. J’ai donc été très frappée d’observer à quel point les auteurs romands n’ont pas connu ce processus d’éloignement par rapport à la référence biblique. Au contraire, elle est toujours là, même si elle est raillée, ou «retournée» de manière subversive – et ce, jusqu’à la profanation, chez un Jacques Chessex. En effet, il n’est pas toujours question d’imiter le modèle biblique en le respectant.
Paradoxalement, vous écrivez que cette référence biblique en Suisse ouvre parfois à plus d’originalité ou de folie qu’en France. Comment cela se fait-il?
C’est peut-être en partie parce qu’ils ou elles ont été marqués par certains livres de l’Ancien Testament, qui sont de grands poèmes, tout comme l’est le Livre de l’Apocalypse, que les écrivains romands ont fait preuve d’autant de singularité dans leurs textes. Dans le Livre de Job ou les Psaumes, il y a un vrai lyrisme poétique, des images très concrètes, un rythme dans la langue. Mais cette liberté formelle, chez les Romands, est peut-être aussi due au fait que, n’ayant pas à correspondre à des critères éditoriaux français et étant en quelque sorte limités à la Suisse romande, certains auteurs d’ici, hommes ou femmes, se sont affranchis de toute idée de genre. Comme un Jean-Marc Lovay, qui quitte Gallimard après trois livres, refusant de rendre son style plus lisible pour le lectorat français, et qui est accueilli par les Éditions Zoé, à Genève.
Faite d’auteurs issus de cantons réformés ou catholiques, la littérature romande est-elle l’espace où cultures catholique et protestante ne se sont jamais autant mêlées?
Il ne faut pas, en effet, restreindre le champ littéraire romand à l’empreinte protestante. La Réforme a bien sûr essaimé dans l’espace culturel qui va de Genève à Neuchâtel en passant par le canton de Vaud, mais les cantons catholiques existent également. Ce qui est intéressant, c’est qu’il y ait eu ce double rapport à la Bible, assez différent de part et d’autre, puisque les écrivains protestants vont insister sur l’Ancien Testament, tandis que les catholiques sont plus tournés vers les Évangiles et le Nouveau Testament. Il y a donc eu, tout à la fois, une empreinte protestante et réformée, ou catholique, et une influence réciproque, jusqu’à un certain point, entre les auteurs. L’universitaire Roger Francillon parle d’une «protestantisation» du catholicisme romand. Je crois que cela joue dans les deux sens.
Si la littérature romande du XXe siècle est truffée de références bibliques, relève-t-elle pour autant d’une recherche spirituelle?
Pour Jean-Marc Lovay, l’écriture même est «instrument spirituel», ouvrant à «l’inconnu du verbe» avec un «v» minuscule. Cette formule, qui déplace le sens religieux vers le sens poétique ou le Verbe divin vers la littérature, «l’unique autre monde possible», selon Lovay, me paraîtrait convenir à beaucoup d’auteurs romands.
Chez Ramuz, on retrouve d’ailleurs l’espoir toujours contrarié d’atteindre par l’écriture une perfection «éternelle». L’écrivain se prend-il pour Dieu?
Il est clair qu’au début du XXe siècle, il y a un transfert de la religion vers l’art. On le voit aussi chez Proust. En Suisse romande, ce travail, c’est vraiment Ramuz qui l’initie de la façon la plus originale et la plus neuve en recourant sans cesse, à l’arrière-plan, au texte biblique, mais en le transposant dans le domaine de l’écriture romanesque. C’est l’écriture qui devient porteuse du sens. Et donc d’un désir de perfection et d’absolu qui existait dans la religion et se voit relayé par le travail littéraire. Quant au fantasme d’être Dieu en écrivant, il accompagne la littérature depuis toujours, le poète ou l’écrivain se mettant à la place de Dieu pour créer. Balzac l’a dit: être romancier, c’est usurper sur Dieu.
On voit chez Chappaz, Bille ou Ramuz une comparaison entre les lieux et images bibliques et la réalité suisse. Y aurait-il dans les paysages suisses quelque chose de profondément biblique?
C’est un peu ce que suggère Chappaz, en effet. Il voit la plaine du Rhône comme une sorte de nouvelle Judée quand Corinna Bille y voit une «terre de la Genèse». Il y a donc fusion imaginaire entre le paysage réel et le paysage biblique, mais je ne crois pas que ce soit vraiment parce que la Suisse ressemble au décor biblique. L’imaginaire de ces trois écrivains étant profondément imprégné de la lecture de la Bible, ils la projettent sur le paysage et, en quelque sorte, lui insufflent une substance biblique. Toutefois, la Suisse renvoie peut-être, parce qu’elle est restée très liée au monde paysan, à un ensemble de gestes traditionnels et à un paysage quotidien qui avaient encore, à l’époque, quelque chose de très biblique.
Jacques Chessex semble avoir dit tout et son contraire sur sa foi dans une production littéraire gorgée de références bibliques. La lecture complète de son œuvre nous permet-elle de trancher sur sa croyance en Dieu?
Non. On se demande vraiment s’il joue de bout en bout avec ces références, ce matériau, tout ce bagage biblique qui est en lui, en s’en servant uniquement pour en tirer de l’écriture, ou s’il s’agit aussi, jusqu’à la fin, d’un questionnement sur l’existence ou non de Dieu. Difficile de trancher. Ma lecture serait plutôt que cette manière paradoxale qu’a Chessex d’être à la fois dans le blasphème et le «désir de Dieu» recouvrait une angoisse, fondamentale chez lui, du vide et du néant.

«Au commencement était le verbe»
Sylviane Dupuis
Éditions Zoé
255 p.