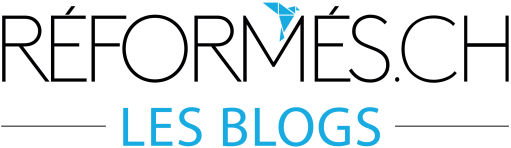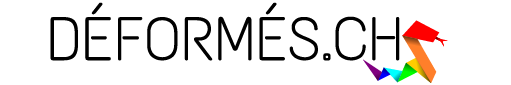Karl Barth, représentant moderne d’une théologie deux fois millénaire
Karl Barth est certes le théologien protestant le plus innovant de la première moitié du vingtième siècle. Il s’inscrit pourtant dans une lignée théologique, laquelle, passant par plusieurs théologiens éminents dont Søren Kierkegaard, Martin Luther et Augustin, remonte à l’apôtre Paul. L’avènement de la « théologie dialectique », dont nous célébrons cette année le centenaire, est d’ailleurs marqué par son commentaire de l’épître aux Romains, œuvre maîtresse de la théologie paulinienne où se trouve affirmée la justification du pécheur par la foi, sans les œuvres.
Karl Barth (1886-1968) interprète l’épître aux Romains selon la perspective de Søren Kierkegaard (1813-1855), qui affirme « la différence qualitative infinie entre Dieu et l’homme ». Le théologien bâlois rompt ainsi avec la théologie libérale de son temps, qui voyait dans la culture moderne, en particulier allemande, un accomplissement de l’esprit du christianisme. Selon Barth, rien de ce qui provient des cultures et des religions humaines – christianisme compris – ne peut nous mener à Dieu, le Tout-Autre. Avoir pour point de départ l’homme et ses questions (son origine, son existence, sa mort, etc.) et chercher des réponses à ces questions dans la religion n’est pas une méthode acceptable en théologie chrétienne, dit Barth, car « le chemin ne va pas de nous à Dieu, mais de Dieu vers nous ». La religion ne peut justifier l’homme, elle ne le libère ni du péché, ni du destin, ni de la mort. La révélation, au contraire, est « l’avènement par lequel Dieu a visité son peuple, s’étant fait l’un de nous, cachant sa gloire dans notre misère ».
On a parlé d’une théologie de la crise : pour Karl Barth, les mots humains que nous utilisons pour décrire la révélation sont en tant que tels inadaptés. Dieu n’est ni un « seigneur », ni un « père », ni un « berger », ni un « juge » comme ceux de notre monde. Ces mots ne témoignent de la réalité de Dieu qu’au moyen de l’« analogie de la foi ». Le péché et la chute ont rendu impossible tout accès direct à Dieu. La Bible n’est pas la révélation, mais ses textes renvoient par analogie à l’événement de la Parole de Dieu, qui est le Christ vivant. Dieu ne révèle rien ni personne d’autre que lui-même, et la révélation n’a pas d’autonomie vis-à-vis de l’agir divin. Elle n’atteint l’homme que lorsque Dieu décide gratuitement et par amour de se révéler à lui, de le justifier et de le sanctifier. Les intentions humaines n’y sont pour rien.
Sa vie durant, par-delà ses différentes périodes, la théologie de Barth restera marquée par la critique du rationalisme, de l’humanisme et du libéralisme théologique. Incapable de connaître Dieu par sa raison, l’homme est appelé à reconnaître « l’impossibilité constitutive de toutes ses possibilités », selon l’expression kierkegaardienne, attitude qui lui ouvre la voie de la grâce au moyen de la foi.
Augustin face au moine Pélage
La tension que nous venons d’évoquer, qui oppose depuis un siècle les théologies libérales aux théologies dialectiques, apparaît déjà dans le Nouveau Testament et traverse toute l’histoire de l’Eglise d’Occident. Cela permet de situer la théologie de Karl Barth dans l’histoire de la théologie, le débat entre l’humanisme théologique et sa critique réapparaissant diversement à chaque époque. Remarquons par ailleurs que la ligne de démarcation entre ces approches plus ou moins optimistes ou pessimistes de l’humain ne coïncide pas avec celle des confessions catholique et protestante.
Dans le Nouveau Testament, la théologie paulinienne, qui accorde une grande importance aux oppositions dialectiques (le péché et la grâce, la chair et l’Esprit, la foi et les œuvres, etc.) se trouve confrontée à d’autres théologies d’origine judéo-chrétienne plus enclines à souligner l’importance de l’éthique et des œuvres de la Loi dans le processus du salut.
Cependant, c’est au début du cinquième siècle de notre ère que le conflit entre les deux lignées se radicalise une première fois entre Augustin, l’évêque d’Hippone (nord-est de l’Algérie actuelle), et le moine Pélage, d’origine irlandaise. Vers 390, scandalisé par les mœurs relâchées des Romains, Pélage fait de nombreux adeptes en prêchant l’ascétisme chrétien. Pour justifier sa morale rigide, il prétend que la corruption de l’homme n’est pas innée : les enfants naissent innocents et libres de choisir ensuite le bien ou le mal.
Augustin, se réclamant de l’apôtre Paul, nie avec la plus extrême rigueur que l’homme puisse s’autojustifier en accomplissant des œuvres bonnes. Contre Pélage, il affirme que les enfants naissent pécheurs, la faute d’Adam se transmettant de génération en génération. Selon sa doctrine du « péché originel », l’homme ne peut ni vouloir ni faire le bien. Augustin durcit ses positions après avoir assisté au pillage de Rome par les Vandales. L’humanité est à ses yeux une massa perditionis, vouée à la damnation. La rémission des péchés et le salut dépendent entièrement de la prédestination, décision prise de toute éternité par Dieu.
Niant la doctrine du péché originel, Pélage estime que la faute d’Adam est tout au plus un mauvais exemple que l’homme peut suivre ou non selon son libre arbitre. Il minimise la nécessité de la rémission des péchés par la grâce. Lointain précurseur des théologiens libéraux modernes, auxquels Karl Barth reproche d’ailleurs leur « semi-pélagianisme », Pélage considère que la foi et les dogmes ont peu d’importance, l’essence de la religion étant l’action morale. En 418 après J.-C., le Concile de Carthage ratifie la position d’Augustin et condamne le pélagianisme, légitimant le baptême des enfants, qui seul peut sauver les humains du péché qu’ils ont hérité d’Adam.
Au Moyen-Âge, la théologie scolastique
Le débat ainsi amorcé se poursuit durant tout le Moyen-Âge. Figurant parmi les représentants majeurs de la théologie scolastique, Thomas d’Aquin (1224-1274) réalise une synthèse très structurée de la théologie chrétienne et de la philosophie d’Aristote. Sans adhérer aux prétentions de Pélage au sujet des qualités morales et rationnelles de l’homme, Thomas d’Aquin apporte une « retouche légère » à la doctrine du péché originel héritée d’Augustin. En humaniste modéré, Thomas cherche à valoriser la grandeur de l’être humain et sa capacité à participer à l’œuvre du salut. Il met davantage l’accent sur la grâce sanctifiante, prévue et voulue par Dieu pour tous les hommes.
A ses yeux, l’image de Dieu en l’homme (dont parle Genèse 1,26-27) n’est pas entièrement détruite par le péché originel, mais seulement partiellement dégradée. L’homme est donc naturellement capable de développer un certain nombre de vertus par lesquelles il s’achemine vers la béatitude. Thomas d’Aquin s’appuie sur l’ouvrage d’Aristote l’Ethique de Nicomaque pour définir ces vertus dites « cardinales », que sont avant tout la prudence, la tempérance, la justice, la magnanimité, etc. Ces vertus proportionnées à sa nature permettent à l’homme de s’élever vers Dieu, mais pas de le rejoindre. Le dernier pas qui le sépare de Dieu nécessite les vertus « théologales », proportionnées à la nature divine et divinement infusées en l’homme. Thomas d’Aquin les définit d’après 1 Corinthiens 13,13, comme étant la foi, l’espérance et l’amour. Selon lui, le salut est donc une subtile combinaison d’efforts humains et de dons divins.
Renaissance et Réforme
Il n’y aura pas de réaction plus sévère, plus acharnée, à cette combinaison de théologie et de philosophie que celle du moine augustinien Martin Luther (1483-1546), lequel, dans sa ligne d’un retour exclusif aux Ecritures (sola scriptura), condamnera l’intégration de l’éthique d’Aristote à la théologie scolastique. Suivant son maître Augustin et commentant l’épître de Paul aux Romains, Luther affirme que le salut ne dépend que de la grâce divine (sola gratia) sans le concours des mérites humains. Si Luther doit aux humanistes de son temps la voie vers un accès plus libre aux Ecritures, il se révèle être l’un des plus virulents critiques de l’humanisme de la Renaissance. Dans sa dispute avec le maître humaniste Erasme de Rotterdam (1456-1536), qui affirme la libre et folle capacité de l’homme à imiter le Christ (libre arbitre), Luther affirme avec une détermination sans bornes que l’homme n’est que péché, et que sa faculté de choisir entre le bien ou le mal, entre Dieu ou le diable, dépend entièrement de la prédestination divine (serf arbitre).
Si l’on oublie l’antihumanisme de Luther, on oublie tout autant l’humanisme de Calvin. Dans l’opinion publique, Luther passe même souvent pour être plus « humaniste » que Calvin. Or, la posture de Jean Calvin (1509-1564) est issue de l’école humaniste française, au travers de laquelle le futur réformateur de Genève rencontre les écrits de Luther, dont il se fait le disciple, affirmant que la grâce seule sauve l’homme pécheur. Mais pour Calvin, cette grâce se concrétise dans une vie sainte, rendue possible par l’action de l’Esprit, dont l’effet collectif est le développement d’une société fondée sur les valeurs de l’Evangile. C’est cette ambition humaniste d’une « cité chrétienne » qui rend l’éthique de Calvin plus « exigeante » que celle de Luther. Cette « matérialisation de la grâce » associe le succès économique à la bénédiction divine, rendant ainsi visible la prédestination divine au travers de la réussite sociale.
L’époque moderne
A large échelle, les guerres de religion du XVIIe siècle entre catholiques et protestants suscitent au XVIIIe siècle, dit « siècle des Lumières », une distanciation de la religion à tous les niveaux, intellectuel, social, culturel et politique. Les vertus éclairantes de la raison (ce sont « les Lumières ») rendent l’individu autonome vis-à-vis de Dieu, fondant à la fois la privatisation moderne de la sphère intime et l’espace laïque.
Ce nouvel humanisme, fondateur de l’esprit moderne, connaîtra au XIXe siècle de profondes critiques laïques, qui soulignent la négativité de l’homme. Le débat théologique au sujet de la nature humaine se trouve ainsi déplacé dans le monde séculier. Marx dénonce la domination du capital, Freud celle de l’inconscient, quand Nietzsche appelle à une subversion de toutes les valeurs. Pour le philosophe protestant Søren Kierkegaard (1813-1855), précurseur de l’existentialisme chrétien au XXe siècle, l’histoire humaine est avant tout le lieu de l’angoisse. L’homme est constamment confronté à la nécessité de choisir et au risque de l’échec menant au désespoir. La foi est la seule victoire qui triomphe du monde. Kierkegaard se confronte au chef de file de l’idéalisme allemand, G. W. E. Hegel (1770-1831), qu’il décrit comme un « écrivailleur d’absurdités » en raison de sa vision positive de l’histoire humaine, lieu d’accomplissement progressif de l’Esprit divin.
C’est cet idéal de la société chrétienne, auquel adhèrent certains disciples de Hegel et plusieurs théologiens libéraux allemands, allant jusqu’à justifier théologiquement l’effort de guerre allemand, que Karl Barth juge inacceptable, au moment où éclate la Première guerre mondiale. L’idéal humaniste chrétien s’est profondément mépris sur lui-même. Son orgueil a mené à une guerre de tranchées. Sur le plan exégétique, Albert Schweitzer (1875-1965) a lui aussi remis en question la vision libérale du message de Jésus, en soulignant que la réalisation du règne de Dieu dont parlent les évangiles bibliques ne peut être réduite à un processus social et culturel, mais se situe dans une dimension résolument transcendante.
Conclusion
En conclusion de ce bref parcours historique, il me semble pertinent de retenir que les théologies dialectiques comme celle de Karl Barth, qui soulignent l’incapacité de l’homme à se réaliser par lui-même, autant que les théologies libérales, qui valorisent l’humanité de l’homme, méritent chacune une écoute attentive, tout comme leurs antécédents historiques. Depuis deux millénaires, leur complémentarité crée un espace de réflexion fructifiant à l’intérieur et au-delà de la théologie chrétienne. Les deux tendances s’équilibrent l’une l’autre, alors même que leurs théologies ne sont que partiellement compatibles.
La force des théologies dialectiques consiste en leur résistance à toute forme de complaisance humaniste envers les qualités morales de l’homme. Ces théologies font preuve de courage en rappelant que la vie humaine est profondément entachée par le péché et la mort, et que l’homme ne saurait créer un monde idéal sur Terre. L’expérience « suprême » de la croix – d’où la dénomination de « théologie de la croix » attribuée à la théologie de Luther – renferme à la fois la révélation de la nature profonde de l’homme, et la révélation du « moyen » choisi par Dieu pour vaincre cette nature.
Karl Barth a réfléchi sa vie durant aux limites de la théologie dialectique, les situant notamment dans la théologie politique, selon laquelle il existe une « analogie » (le contraire de la « dialectique ») entre l’œuvre de Dieu (la justification du pécheur) et les œuvres humaines (la justice politique). Barth n’a jamais ignoré cette dimension de l’engagement social et politique, notamment contre le nazisme. Le risque de la théologie dialectique consiste en effet à absolutiser la distance entre Dieu et l’homme, écartant la foi de toute concrétude, au point de négliger l’engagement spirituel, communautaire et social du chrétien. Comme Albert Schweitzer l’a montré, le caractère dialectique de la théologie de Paul ne la prive pas d’une mystique, c’est-à-dire d’une pensée de la proximité – voire même de l’unité – de Dieu et de l’homme dans « l’être en Christ ». Les théologies dialectiques affirment que cette unité « en Christ » est l’œuvre de Dieu seul, et qu’elle reste donc incompréhensible, puissance divine cachée dans la faiblesse de la foi.
Les théologies libérales, pour leur part, ne cessent de rappeler qu’on ne peut parler de la foi en Dieu sans établir un certain rapport entre cette croyance et la vie concrète de l’homme. La crucifixion du Christ, plus qu’un événement indissociable du salut du pécheur, est perçue comme un revers de Dieu auquel ce dernier riposte en ressuscitant Jésus et en entrainant l’humanité dans cet élan vital. La religion se situe majoritairement sur le plan de l'éthique. Hormis ce lien pratique, la foi ne serait qu’une vaste hypocrisie, voire une justification de la médiocrité, selon l’aphorisme de Nietzsche. L’expérience spirituelle ne saurait être pensée sans ses dimensions psychologique et relationnelle ; en d’autres termes, sans sa profonde « incarnation » dans l’épaisseur de la réalité humaine.
Remarquons pour conclure que dans le culte réformé actuel, le moment liturgique de la confession des péchés et celui de l’engagement spirituel, sous forme de prière d’intercession et d’offrande, coexistent sans nullement se télescoper, illustrant ainsi la complémentarité des tendances dialectiques et libérales.
Gilles Bourquin