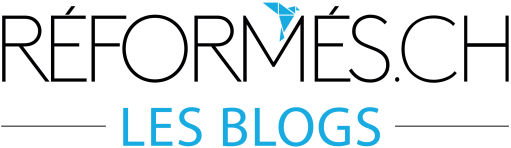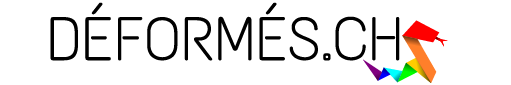La santé, le bien le plus important?
La politique semble ne connaître actuellement qu’un seul thème : la lutte contre le coronavirus. Cette lutte est menée au nom de la santé, reconnue subitement comme le bien le plus important, le bien dont la préservation justifie tous les sacrifices ou presque. La lutte contre le coronavirus obéit à une maxime : réduire autant que possible le nombre des infections. On en a déduit le nouvel impératif catégorique que l’on cherche à nous imposer comme le principe de toute morale par temps d’infection : reste à la maison ! Mais Kaliningrad, l’ancienne Königsberg, annonce que le fantôme de Kant est sorti de sa tombe et refuse de se soumettre à cet impératif. Peut-être cela devrait-il nous inviter à quelques réflexions critiques.
Est-il vrai que nous fassions toujours et en toutes choses de la santé le bien le plus important, le bien auquel tous les autres doivent être soumis ? Le retour sur quelques débats de ces dernières années devrait nous convaincre que ce n’est pas le cas. J’ai déjà évoqué dans un papier récent le problème de la politique du tabac : les Chambres fédérales ont édulcoré la loi censée limiter la publicité pour le tabac au point que celle-ci en perdait toute efficacité. Inutile de souligner que le souci de la santé publique aurait dû conduire au contraire à une politique plus restrictive. Non que je plaide pour une interdiction du tabac, comme semblent l’avoir compris certains de mes lecteurs. Ce qu’il m’importe, c’est de pointer une incohérence : le refus de limiter de façon drastique la publicité pour le tabac montre que le souci de la santé n’est pas le principe premier sur lequel s’orientent usuellement les décisions politiques.
Il en va de même dans le domaine du don d’organes. On le sait, la Suisse manque de donneurs d’organes. Il en suit un certain nombre de décès (68 en 2018) qui pourraient probablement être évités si le nombre de donneurs potentiels était plus élevé. Pour atteindre ce but, il existe une solution simple : changer le cadre légal. À l’heure actuelle, seule une personne qui a rempli avant son décès une carte de donneur est considérée d’office comme une personne sur laquelle il est loisible de prélever un ou plusieurs organes. Dans tous les autres cas, il faut consulter la famille pour déterminer quelle aurait été la position du défunt. Cela revient à reconnaître un droit de veto à la famille. Et cela réduit fortement le nombre de donneurs potentiels. D’où la suggestion de changer le cadre légal et de passer à la solution dite du consentement présumé : toute personne qui ne fait pas inscrire son refus dans le registre prévu à cette fin est présumée donner son accord à un prélèvement d’organes après constat de sa mort cérébrale. Une votation populaire aura probablement lieu sur cette question puisqu’une initiative populaire a été déposée. Mais d’ores et déjà, de nombreuses voix s’élèvent, y compris dans les Églises, pour s’opposer à cette solution. En Allemagne, le parlement vient de refuser, à une solide majorité, d’adopter cette solution, pourtant favorisée par le gouvernement et le ministre de la santé ; il lui a préféré une proposition de loi présentée par les Verts, qui maintient l’exigence d’un consentement explicite de la personne (ou de ses proches) mais introduit une obligation d’information. Dans le présent contexte, les arguments des uns et des autres sont sans importance. L’existence du débat (et la décision, que pour ma part je salue, du parlement allemand) suffit à montrer que nous ne sommes pas disposés, dans ce cas aussi, à accorder une priorité absolue à la santé.
On pourrait énumérer nombre d’autres exemples. J’y renonce, car ils ne changeraient rien à la conclusion : en général, les règles que nous adoptons dans le cadre du processus démocratique n’accordent pas à la santé une priorité absolue. Elles considèrent au contraire cette dernière comme un bien parmi d’autres, qui doit faire l’objet d’une pesée des intérêts quand il entre en conflit avec d’autres biens. C’est pourquoi on soumet à une évaluation critique les mesures envisagées au nom de la préservation de la santé : la seule démonstration de leur effet bénéfique en termes de santé ne suffit pas à leur justification. La santé est un bien parmi d’autres, elle n’est pas le bien le plus important. Cette conviction ne guide pas seulement les décisions politiques ; elle motive manifestement aussi le comportement quotidien de la plupart de nos contemporains. Dans la table des valeurs de nos sociétés, la santé occupe certes une place de choix, mais elle n’est ni la seule valeur à y figurer, ni la valeur la plus importante.
Mais depuis quelques semaines, on assiste à un bouleversement de cette table des valeurs. En raison de la pandémie due au coronavirus, la santé semble être devenue le bien le plus important, et même le seul bien qu’il importe de préserve quoi qu’il coûte. Pour préserver la santé de tous, nous dit-on, il convient que tous acceptent des restrictions gravissimes de leurs libertés fondamentales. Pour préserver la santé de tous, chacun doit être prêt à voir réduit à néant le fruit d’années de travail et d’investissements importants. Pour préserver la santé de tous, nous devons être accepter que les mesures décidées provoquent une récession qui risque fort d’être plus grave que la crise économique de 1929 (c’est du moins ce dont est persuadé un nombre croissant d’économistes). Litanie sans fin des conséquences de l’impératif catégorique par temps de pandémie : reste à la maison ! Mais comme le sait tout lecteur de Kant, le propre d’un impératif catégorique est que sa validité n’est pas soumise à condition. Il vaut de façon absolue, quelles qu’en soient les conséquences.
Ce bouleversement semble s’imposer à la plupart de nos contemporains comme une sorte de nécessité naturelle contre laquelle il serait vain de s’insurger. Les mesures prises seraient sans alternative. Les seuls débats portent sur la nécessité de prendre des mesures encore plus strictes, de durcir encore les interdictions : en Suisse romande en particulier, on semble appeler de ses vœux la transformation du pays en une vaste léproserie où la police veillerait à empêcher toute velléité de transgresser le nouvel impératif catégorique : reste à la maison ! La liberté, voilà l’ennemi de la santé. Sus donc à la liberté !
Comment expliquer ce bouleversement de notre table des valeurs ? Avons-nous subitement découvert la valeur éminente et quasi exclusive que, tout bien considéré, il convient d’accorder à la santé ? Je n’en crois rien, et je suis prêt à parier que les décisions politiques qui seront prises lorsque la pandémie sera passée montreront qu’il n’en est rien. Quel est alors le motif de ce bouleversement de notre table des valeurs ?
J’aimerais oser une hypothèse. La crise pandémique confronte nos sociétés occidentales à une expérience inédite : celle d’un événement que nous ne pouvons pas maîtriser et qui expose nos systèmes collectifs de sécurité (en l’occurrence le système de santé) aux limites inhérentes à tout système, tant il est vrai qu’aucun système ne dispose de ressources illimitées. C’est cette expérience de nos limites qui nous est insupportable. Nous faisons tout pour l’éviter. Le véritable impératif est de ne pas surcharger le système de santé. Car le système de santé est devenu le symbole de ces systèmes censés garantir notre sécurité en nous assurant la maîtrise des risques auxquels toute vie est exposée.
Ce que la pandémie actuelle nous oblige à redécouvrir, c’est que notre vie est exposée à des risques que nous ne maîtrisons pas, et que nous ne pouvons pas maîtriser. Les philosophes parlent à ce propos de contingence. Les mesures de plus en plus drastiques prises pour combattre la pandémie essaient de nous faire accroire que, malgré tout, nous parviendrons une fois encore à maîtriser la contingence. C’est évidemment illusoire. Mais cette illusion de maîtrise absolue est l’élixir qui fait vivre nos sociétés contemporaines. Le principe de précaution n’en est que l’autre face : éviter d’exposer autrui et soi-même à un risque, c’est encore conserver la maîtrise de la situation. Car le risque est par définition ce qui échappe au contrôle de celui qui y est exposé.
La peur panique de ce qui échappe à notre maîtrise est sans doute le véritable ressort de ces injonctions adressées par toute la presse aux personnes les plus exposées aux effets du coronavirus : restez à la maison ! Nous ne voulons pas être les témoins d’une perte de maîtrise due à une prise de risque que nous considérons comme inutile, même si nous n’en sommes pas les victimes. Et pour ne pas être témoins de cette perte de maîtrise, nous sommes prêts à sacrifier notre liberté et à contraindre les autres à faire de même, tout au moins pour un temps. C’est le prix à payer pour ne pas être confronté à l’expérience douloureuse de nos limites et de la contingence radicale de la vie humaine. Le paradoxe de la situation actuelle est que les mesures prises pour nous épargner la confrontation avec la contingence radicale de la vie humaine nous exposerons à d’autres formes de contingence, en particulier économiques. Mais nous croyons, à tort probablement, qu’elles seront plus faciles à maîtriser.