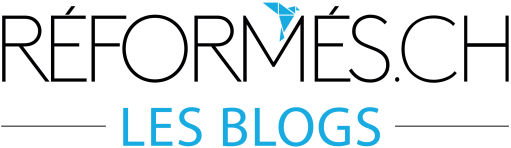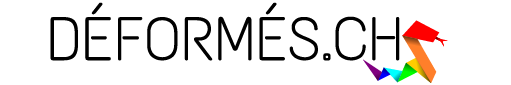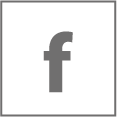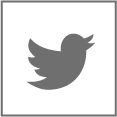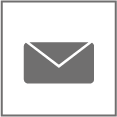Faire parler les murs
Soufiane Chinig a grandi à Salé, métropole de près d’un million d’habitants qui fait face à Rabat, capitale du Maroc. Dans cette ville à l’urbanisation anarchique, graffeur·e·s et streetartistes s’en donnent à cœur joie. Soufiane Chinig connaît bon nombre d’acteurs de cette scène. Il est lui-même promoteur de l’héritage culturel marocain et fin observateur des évolutions de la planification urbaine, ainsi que de la sociologie de certains quartiers et bidonvilles. Sur les murs du Maroc ou de la Jordanie – deux monarchies qui n’ont pas été renversées et qui tirent leur légitimité de leur prétendue descendance du prophète Muhammad – il observe des reconfigurations sociales récentes, notamment religieuses.
Quels liens voyez-vous entre street-art et religion?
Par définition, le street art est vu comme une culture populaire, laïque et séculière, née en Europe et aux Etats-Unis. On l’a toujours vu comme séparé des cultures locales, considérées comme «islamiques» dans les pays arabes. En réalité, cette pratique est très ancienne, y compris dans les pays musulmans: depuis toujours, les gens écrivent sur les murs pour parler d’amour, d’amitié, de famille et de poésie.
Les artistes actuels au Maroc et en Jordanie mobilisent un héritage culturel sunnite ou amazigh (berbère). Ces pays où l’islam est dominant sont de tradition discursive, c’est-à-dire qu’elle donne beaucoup de place au discours religieux, et ils se retrouvent travaillés par la modernité. Une modernité qu’on peut définir comme un projet politique, économique, culturel et laïque dans lequel la religion a un discours sur elle-même. A travers l’art mural, la religion «officielle» tente de s’adapter à cette modernité «forcée»: elle essaye de montrer, sans le dire, que la modernité peut être islamique.
Comment une religion «officielle» peut-elle s’exprimer dans un art par définition illégal?
Avant «les printemps arabes», il y a eu des attentats au Maroc (à Casablanca, le 16 mai 2003). L’Etat marocain a adopté un combat culturel en faveur de l’islam modéré et il a financé l’art pour combattre «les sources fertiles» du radicalisme et de l’extrémisme. Cela a entraîné le passage de l’art des galeries vers les rues, de l’abstrait vers le concret, avec des expressions très locales. Cet art subventionné est une tentative de redéfinir le regard envers l’islam.
Comment?
L’esthétique est influencée par le discours religieux et politique: elle ne montre pas de nudité par exemple. Au Maroc, des associations sont subventionnées pour produire des portraits de femmes amazigh avec, en arrière-plan, des calligraphies et des versets coraniques. Le message est clair: on reconnaît la «berbérité» dans le cadre de l’islam, qui est vu comme importateur de civilisation en Afrique du Nord. Alors que le mouvement amazigh lutte en réalité contre l’arabité basée sur l’islam. L’Etat marocain essaye de reconnaître ses origines, mais en gardant sa légitimité religieuse. C’est assez semblable en Jordanie, où l’Etat-nation adresse la diversité culturelle interne à travers l’art, tandis que la source de légitimité et le cadre esthétique restent «islamiques».
La thèse en bref
Titre de la recherche doctorale: Pratiques, récits et politiques visuelles du graffiti et du street art en Jordanie et au Maroc.
Domaine : anthropologie sociale et culturelle.
Soutenance : septembre 2024 auprès de la Berlin Graduate School for Muslim Cultures and Societies, au sein de la Freie Universität de Berlin.
Visiter le site de la Freie Universität Berlin pour en savoir plus sur le travail de Soufiane Chinig.