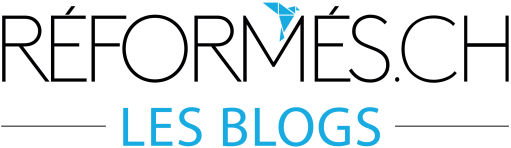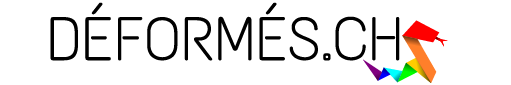L'apocatastase: la nouvelle tâche de l'État?
L’apocatastase : voilà un terme que seuls les théologiens, et peut-être quelques philosophes, connaissent encore. Il signifie littéralement : restauration ou rétablissement dans l’état originel. Dans l’histoire de la théologie chrétienne, il désigne la doctrine selon laquelle, à la fin des temps, Dieu restaurera toutes choses en leur état originel et, en particulier, fera participer tous les hommes au salut. Si l’on veut la ramener à une formule simple, on peut y voir la position affirmant que l’enfer est vide. L’apocatastase enseigne que tous seront sauvés et que, par conséquent, le jugement dernier n’aura pas lieu.
Mais le salut est-il uniquement une question concernant l’au-delà, ce qui vient après la mort ? On peut en douter. Le grand sociologue Max Weber suffirait à nous le rappeler. Il relève que le salut est le plus souvent une réalité d’ici-bas ; les êtres humains souhaitent avant tout être délivrés des vicissitudes terrestres : pauvreté, maladie, mort prématurée, absence de descendance. Les promesses de salut répondent d’abord à ces demandes.
C’est vrai aussi des promesses bibliques : Dieu promet à Abraham un pays et une descendance nombreuse ; Moïse et le peuple hébreu se voient promettre un pays dans lequel coulent le lait et le miel ; les visions prophétiques des temps derniers font confluer tous les peuples à Jérusalem pour rendre hommage au Dieu d’Israël et assurer ainsi à son peuple le rôle d’un peuple de rois et de prêtres.
Le salut ne concerne donc pas seulement ni d’abord l’au-delà ; il est aussi, et souvent exclusivement, une réalité de l’ici-bas. C’est particulièrement vrai aujourd’hui. Les demandes de spiritualité sont d’abord des demandes de bien-être. La faveur dont jouit le bouddhisme en est peut-être l’indice le plus probant : nos contemporains y cherchent une forme d’apaisement, de sérénité, un accord avec eux-mêmes et avec la nature. Cette spiritualité s’accompagne volontiers de pratiques rituelles, surtout alimentaires, dont le véganisme est la plus fréquente. Le tout peut s’allier à une éthique utilitariste trouvant le bien suprême dans le bien-être du plus grand nombre d’êtres vivants, animaux compris. Plus besoin alors de poser la différence fondamentale entre un ici-bas et un au-delà, entre les réalités avant-dernières de cette vie et Dieu comme réalité ultime.
C’est dans le cadre de cette recherche d’un salut ici-bas qu’il faut, me semble-t-il, placer la crise du coronavirus à laquelle nous sommes actuellement confrontés. Pour la plupart de nos contemporains (qu’ils se considèrent ou non comme chrétiens, juifs, musulmans ou bouddhistes), la perspective d’un salut dans l’au-delà a perdu toute pertinence ; les seules réalités salutaires qui conservent quelque signification sont les réalités d’ici-bas, ces réalités qui ont de tout temps été investies d’une valeur religieuse : longévité, richesse, pouvoir. La première d’entre elles est évidemment la longévité. Qui voudrait aujourd’hui renoncer comme Achille à une longue vie au profit d’une vie glorieuse de héros, même s’il devait être immortalisé par quelque Iliade moderne ?
Du coup, voici l’État chargé d’assurer à tous une longévité maximale, c’est-à-dire la participation à la seule forme de salut possible pour tous ici-bas. Mais n’est-ce pas reconnaître à l’État un rôle quasi religieux ? Les images de la pandémie semblent le confirmer. Les morgues remplies des cercueils de victimes du covid-19 sont l’illustration moderne de l’enfer. Les hôpitaux contraints de décider à qui des soins seront prodigués et à qui ils seront refusés deviennent la forme contemporaine du jugement dernier : on y décide de ceux qui auront part à la promesse séculière de salut qu’est une longue vie et de ceux auxquels la participation à cette promesse sera refusée. Aussi l’État doit-il tout entreprendre pour que ce jugement dernier n’ait pas lieu. Il se retrouve du même coup devoir assurer une forme séculière d’apocatastase. Éviter la surcharge du système sanitaire devient un impératif à valeur presque religieuse. C’est à ce prix que pourra se réaliser la promesse séculière de salut qu’est la longévité.
Chargé de garantir une apocatastase séculière, de vider l’enfer des morgues et d’éviter le jugement dernier du triage, l’État devient une institution du salut, comme l’était classiquement l’Église. Mais, à la différence de l’Église, il ne renvoie pas, au-delà de lui, à une réalité ultime, Dieu, qu’il proclamerait sans pouvoir prétendre l’incarner. L’État qui promet à tous la longévité postule être cette réalité ultime. Dans la crise économique, l’État était déjà le prêteur de dernier ressort (en assurant le financement des banques), l’assureur de dernier ressort (en garantissant les crédits accordés aux PME) et même l’employeur de dernier ressort (par le biais de l’assurance chômage). Il devient en outre l’auteur et le garant des promesses de longévité, cette forme séculière du salut. En toutes choses, l’État est la réalité ultime.
À ce titre, l’État édicte les règles auquel tout un chacun doit se conformer s’il veut vivre et ne veut pas exposer autrui à la mort. Comme instance de salut, il nous enjoint de suivre ses commandements et les conseils paternalistes qu’il nous donne : « Je mets devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur, moi qui te commande aujourd’hui d’aimer le Seigneur ton Dieu, de suivre ses chemins, de garder ses commandements, ses lois et ses coutumes. […] C’est la vie et la mort que j’ai mises devant vous, c’est la bénédiction et la malédiction. Tu choisiras la vie pour que tu vives, toi et ta descendance […]. C’est ainsi que tu vivras et que tu prolongeras tes jours […]. » (Dt 30, 15 et 19-20). Face à la pandémie, l’État se pose en nouveau Moïse. Les règles et les conseils de l’État sont les voies du salut séculier conduisant à la longévité.
Mais reconnaître à l’État la tâche éminemment religieuse de l’apocatastase, c’est lui conférer un rôle qu’il est incapable de remplir. Pour essayer d’exaucer la promesse de longévité, l’État doit en effet prendre des formes qui sapent sa légitimité démocratique. Il n’est plus le garant des droits fondamentaux de l’individu, mais le garant de sa survie biologique.
C’est une modification fondamentale du rôle de l’État. Comme garant des droits fondamentaux, l’État fait de la dignité humaine le principe suprême de son action tout en sachant ne pas être à l’origine de cette dignité. Cette dignité a par conséquent pour fonction de limiter le rôle de l’État ; elle détermine une dimension que l’État n’a pas le droit de violer et qui, à ce titre, fonde la légitimité de cet État. L’État garant de la dignité humaine est un État modeste, conscient de ses limites.
Il n’en va pas de même de l’État promu au rôle d’instance de salut, et garant à ce titre de la promesse de longévité. Pour tenter, en vain, d’exaucer cette promesse de salut, il doit revendiquer un pouvoir presqu’absolu, devenir un dieu, comme le Léviathan de Hobbes. Un dieu mortel, certes, mais un dieu malgré tout.
Concrètement, et nous le voyons ces dernières semaines, l’État ne peut promettre la longévité qu’en mettant en veilleuse les droits fondamentaux, et souvent même le respect de la dignité humaine. La façon dont, dans nombre de pays européens, la lutte contre la pandémie a pour corollaire le refus de toute forme d’accompagnement des mourants en est un indice aussi clair qu’inquiétant. Laisser mourir les malades seuls par crainte d’une possible contagion, c’est leur refuser une mort digne. La lutte pour la survie s’avère incompatible avec les valeurs d’humanité les plus élémentaires, au moment où elles sont le plus nécessaires : face à la mort, c’est-à-dire au moment où les promesses séculières de salut touchent à leur limite.
En promettant à tous une longue vie, l’État s’expose en outre au déni que ne manquera pas de lui infliger la réalité. L’inquiétude face aux risques liés à la levée des mesures de confinement en est l’indice le plus évident. La menace que fait peser le coronavirus ne cessera pas comme par enchantement le 26 avril ou le 3 mai prochain. Pour de longs mois, voire des années, subsistera le risque d’une nouvelle vague. Aussi nous prépare-t-on à des restrictions à long terme, jusqu’à Noël, voire au-delà. Pour nous promettre la longévité, l’État doit continuer à nous imposer des règles de comportement restrictives.
Mais ces mesures ne suffiront pas. L’État est incapable de garantir une longue vie. À s’y essayer, il se heurte aux limites de son efficacité. Il ne peut les repousser qu’en renonçant à garantir la seule chose qu’il soit capable d’assurer : le respect inconditionnel de la dignité humaine jusqu’aux portes du trépas. Il est urgent que l’État cesse de vouloir assurer notre salut séculier et reconnaisse son incapacité à garantir notre longévité. C’est le rôle des Églises de le lui rappeler. Pâques est peut-être pour cela le moment adéquat.