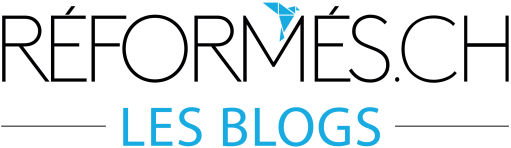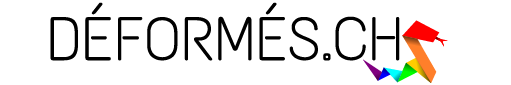Crise sanitaire et urgence de l'éthique
On ne cesse de le répéter : la crise, c’est l’heure de l’exécutif. Dès lors que le Conseil Fédéral proclame la « situation exceptionnelle », il peut gouverner par ordonnance, sans passer par le parlement, et imposer ces mesures aux cantons. À cela s’ajoute une spécificité suisse, particulièrement problématique dans ce genre de situation : l’absence d’une cour constitutionnelle susceptible d’examiner les mesures prises par le gouvernement et, le cas échéant, de les annuler si elles devaient se révéler abusives. En Suisse, rien ni personne ne contrôle le gouvernement lorsque celui-ci use des pleins pouvoirs que lui accorde la loi sur les épidémies.
Mais est-ce vraiment l’heure de l’exécutif ? On peut en douter quand on voit la place prise dans les conférences de presse et les déclarations officielles par les experts, tels Daniel Koch (le directeur de l’Office fédéral de la santé) en Suisse ou Christian Dorsten en Allemagne. La crise du coronavirus, c’est l’heure des épidémiologues au moins autant que celle des exécutifs. Ce sont eux qui disposent du savoir spécialisé capable d’orienter les politiques, de leur proposer des scénarios et de leur suggérer des mesures sanitaires. En un sens, c’est parfaitement normal, et même souhaitable : on n’ose imaginer quelles mesures prendraient les exécutifs s’ils devaient se contenter de leur propre compétence en ces matières. Le rôle des experts dans cette crise sanitaire doit toutefois être regardé d’un œil un peu plus critique. Pour trois raisons.
- Le savoir dont disposent les experts à propos du coronavirus est limité, et surtout, il est largement hypothétique. J’ai déjà relevé que nous ne connaissons pas jusqu’aujourd’hui le taux de létalité du coronavirus : nous ne savons pas quel est le pourcentage des personnes infectées qui décèdent. Cela rend toute projection fort incertaine. Nous ne savons pas non plus combien de personnes ont été infectées sans développer le moindre symptôme. Or ce chiffre est d’une importance capitale : selon toute vraisemblance, les personnes infectées ont développé des anticorps qui les mettent à l’abri d’une nouvelle infection (à la différence du virus de la grippe, le coronavirus ne semble guère se modifier). Plus le nombre de personnes ayant développé des anticorps est élevé, moins le coronavirus peut se répandre.
Sur la base de leur savoir limité, les experts proposent des modèles reposant sur des hypothèses plus ou moins vraisemblables (sans qu’ils puissent toujours préciser quelle est la vraisemblance de leurs hypothèses de départ). Or même lorsqu’un modèle repose sur des hypothèses fort bien confirmées (ce qui n’est pas le cas s’agissant du coronavirus), il n’est jamais une image fidèle de la réalité. Un modèle simplifie la réalité en ne retenant que certains facteurs jugés particulièrement pertinents ; il propose une image idéalisée (c’est-à-dire conforme à une idée) de la réalité, une image dans la construction de laquelle n’interviennent que les facteurs sélectionnés comme pertinents. Un modèle n’est donc pas une description de la réalité ni une prédiction fiable de l’évolution d’une situation, mais une construction mathématique qui sert d’outil pour mieux comprendre la réalité.
Un exemple simple permet de saisir le problème. La crise sanitaire provoquée par le coronavirus est en première ligne une crise provoquée par la rareté de certaines ressources, en particulier par le nombre limité de places en réanimation disponibles dans les hôpitaux. Les modèles cherchent donc à prédire le moment où le système de santé sera surchargé parce que le nombre de personnes nécessitant des soins de réanimation sera plus élevé que le nombre de places disponibles dans le système de santé. Les mesures suggérées par les experts visent à repousser ce moment. Dans leurs modèles, les experts partent de l’hypothèse que toutes les personnes qui requièrent de tels soins désirent recevoir ces soins. Ils ne prennent donc pas en compte les directives anticipées et autres décisions prises par les malades ou leur famille. Or, comme le relevait Daniel Koch samedi 28 mars, parmi les personnes atteintes du coronavirus, un nombre important de malades qui nécessiteraient des soins lourds de réanimation ont déclaré n’en pas vouloir. Du coup, le système hospitalier suisse n’est pas surchargé, et ne semble pas devoir l’être ces prochains jours, alors que de nombreuses projections prévoyaient une surcharge imminente.
- Cet exemple est particulièrement instructif : il met en évidence l’interférence entre deux sphères dont les relations sont complexes : l’épidémiologie et l’éthique. Les directives anticipées sont en effet l’expression des choix éthiques de l’individu, de ce pouvoir d’être soi qui constitue sa liberté (cf. mon papier de blog « La santé est la condition de la liberté. » Vraiment ?). Ce facteur ne peut être pris en compte dans un modèle épidémiologique qui, par souci légitime de méthode, considère l’être humain uniquement comme un maillon d’une chaîne d’infection, au même titre qu’un chat, une perruche ou un rat dans le cas d’autres maladies infectieuses. Dans un tel modèle, la seule chose qui compte est de parvenir à interrompre la chaîne d’infection. Pour cela, il faut limiter au maximum les contacts entre les individus dont on ne sait pas s’ils sont ou non porteurs du virus. Les modèles épidémiologiques servent de bases théoriques pour recommander au pouvoir exécutif les mesures susceptibles d’interrompre la chaîne infectieuse : distanciation sociale, confinement, etc. Or, et c’est là le point problématique, ces mesures reposent sur un modèle qui est aveugle aux questions éthiques : les mêmes mesures s’imposeraient à une population de rats ou de poissons rouges. C’est seulement après coup que l’on pose un raisonnement censé justifier les mesures épidémiologiques d’un point de vue éthique : les mesures d’isolement ou de confinement permettront de sauver des vies ; or sauver des vies est un devoir absolu (ce qu’on appelle un impératif catégorique) ; donc les mesures prises sont non seulement justifiées d’un point de vue éthique, elles sont même éthiquement nécessaires.
J’ai déjà dit à plusieurs reprises mes doutes sur la validité de ce raisonnement. C’est surtout la seconde thèse qui me paraît problématique. Sauver des vies n’est pas un impératif catégorique ! Il n’est pas vrai qu’en toutes circonstances et quelles qu’en soient les conséquences, il faille sauver des vies. D’abord parce qu’il est possible qu’en certaines circonstances, une personne ne souhaite pas que l’on sauve sa vie (c’est par exemple le cas lorsqu’elle formule des directives anticipées ou qu’elle fait appel à Exit). Ensuite parce que nul ne peut prétendre à ce que l’État attente aux droits d’autrui pour sauver sa vie, ou viole à cette fin les principes fondamentaux de l’État de droit (un cas de figure qui se présente lorsque des terroristes prennent des otages pour contraindre un État à libérer des prisonniers). Enfin, parce que la vie humaine est certes un bien important, mais qu’elle n’est pas le bien suprême. Toutes les personnes qui mettent leur vie en péril pour rester fidèles à leurs idéaux ne cessent de nous le rappeler.
Nous ne pouvons donc pas admettre sans discussion le raisonnement utilisé pour justifier les mesures prises pour lutter contre l’épidémie causée par le coronavirus. Il n’y a pas de raisonnement simple qui permettrait de passer des modèles épidémiologiques aux décisions politiques.
- Parce qu’il n’y a pas de passage simple entre les modèles épidémiologiques et les décisions politiques, la délibération éthique est nécessaire. En Suisse, elle fait cruellement défaut. Certes, la Commission nationale d’éthique a publié un communiqué de presse[1]. Mais ce texte se contente de quelques platitudes de circonstance, sans proposer la moindre piste de réflexion critique. Quant au chapitre rédigé en 2006 par la même commission pour le plan pandémie de la Confédération[2], il pose sans la moindre discussion que « la vie d’un être humain est le bien le plus précieux puisque tous les autres en dépendent ». Cette thèse est contestable, comme je me suis efforcé de le montrer. Pour ma part, je ne craindrais pas de la dire fausse. En tout état de cause – et c’est un trait récurrent des prises de position de la Commission nationale d’éthique –, on souhaiterait davantage de discussion critique et argumentée et moins d’affirmations catégoriques. Dans la situation actuelle, ni le chapitre « Éthique » du plan pandémie ni le communiqué de presse ne fournissent les éléments nécessaires à une réflexion critique. Quels seraient ces éléments ?
Le premier élément est le plus évident : les mesures prises par le Conseil fédéral empiètent gravement sur les droits fondamentaux garantis par la Constitution fédérale. Certes, aucun droit n’a de valeur absolue. Mais leur noyau est inviolable. Et toute restriction doit obéir au principe de proportionnalité. Cela signifie que les bénéfices attendus d’une mesure doivent être plus importants que les effets négatifs qu’elle provoquera. Il convient donc de clarifier les critères permettant d’évaluer tant les bénéfices obtenus par une mesure déterminée que les préjudices que cette même mesure crée. Il faut également envisager d’éventuelles mesures alternatives, qui doivent naturellement faire l’objet d’une évaluation similaire.
Il est surtout nécessaire de mener une large discussion sur ce que j’appelais notre table des valeurs (une formule empruntée à Nietzsche). C’est le deuxième élément. Quelles sont les valeurs sur lesquelles s’orientent réellement notre agir social et politique ? Les valeurs réellement incarnées par notre agir social correspondent-elles aux valeurs auxquelles nous prétendons adhérer ? Existe-t-il quelque chose comme une table des valeurs partagée par la grande majorité de la société suisse ? Ou bien la table des valeurs auxquelles un individu souscrit dépend-elle du milieu social auquel cet individu appartient ? Ces questions sont en porte-à-faux entre la sociologie et l’éthique. Mais elles ouvrent sur une question proprement éthique : les valeurs reconnues, à un titre ou à un autre, par la société suisse sont-elles en conflit entre elles ? Et si tel est le cas, comment ce conflit peut-il être géré ?
Vous l’aurez compris, je suis persuadé non seulement qu’il existe un décalage entre les valeurs auxquelles nous disons croire et les valeurs incarnées dans notre agir social et politique, mais aussi que, dans chacun de ces ordres, il existe un conflit des valeurs. C’est le troisième élément à prendre en compte. Avec Max Weber, je suis convaincu que ce genre de conflits n’est pas susceptible d’une solution théorique. C’est pourquoi la discussion éthique est nécessaire. Cette discussion ne débouche pas sur une solution définitive, mais sur des compromis auxquels doit pouvoir souscrire la majorité des personnes concernées.
Dans la situation créée par la crise du coronavirus, il est donc urgent de créer l’espace d’une discussion éthique. Cette discussion doit former un contrepoids au savoir des experts et informer, au même titre que ce savoir, les décisions politiques. Cette discussion est déjà très vive en Allemagne ; elle me paraît inexistante en Suisse romande. Cette absence m’inquiète, car c’est de la vie de notre démocratie qu’il s’agit.
[1] https://www.nek-cne.admin.ch/inhalte/Medienmitteilungen/fr/Communique_CNE_Pandemie_F.pdf
[2] https://www.nek-cne.admin.ch/inhalte/Themen/Stellungnahmen/fr/10_ethische_fragen_fr.pdf