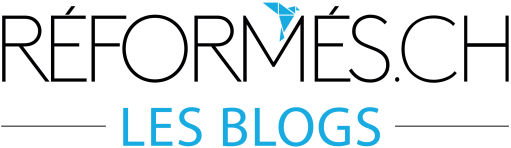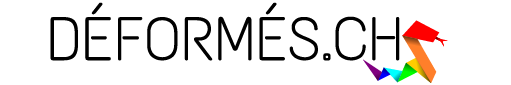Des Églises zombifiées
La lecture d’un récent article d’opinion sur le site de Watson me donne un petit électrochoc. Il y est question de l’aménagement intérieur de la cathédrale Notre Dame de Paris. Alors que le diocèse envisage une sérieuse mise-à-jour destinée à rejoindre les contemporains, l’auteur de l’article, qui se déclare anticlérical, s’en trouve choqué. Au point de se demander s’il ne devrait pas devenir traditionaliste.
A bien y réfléchir, cette réaction me semble emblématique des attentes de larges pans de la population à l’égard des Églises et du christianisme. Certaines innovations dérangent autant, voire plus, que l'hypothèse de leur disparition. En clair, le discours paradoxal qui pèse sur l’Église lui indique qu’elle doit se résigner à devenir un zombie. Tant la vie et son cortège d’évolutions que la mort et sa façon de figer l’histoire représentent des tabous, des infranchissables.
Des zombies dans l’orgue
Ce double interdit opère également à l’interne des institutions religieuses. J’en veux pour illustration une anecdote que m’a récemment raconté un pasteur réformé. L’orgue de l’un des temples de sa paroisse est fortement endommagé suite à un sinistre. Le Conseil se saisit de la question et envisage divers scénarios. Un facteur d’orgues articule un nombre à cinq chiffres dans son devis de réparation. Les responsables de la paroisse hésitent à engager leur patrimoine dans un tel investissement. Un piano serait peut-être tout aussi agréable, plus polyvalent et nettement moins cher. Mais l’orgue a une valeur sentimentale pour quelques paroissiens. Le pasteur, qui plaide en faveur d’un aggiornamento musical, s’emploie à comprendre les hésitations des uns et des autres. Il rencontre individuellement chaque membre du Conseil. Au final, il constate avec soulagement que toutes les résistances ont disparu et que l’achat d’un piano semble en bonne voie. Mais au moment du vote, à sa grande surprise, le Conseil adopte à l’unanimité le financement de l’orgue dans une modalité certes un peu plus économique.
Que s’est-il passé ? Comment un Conseil, dont chacun des membres était convaincu de l’option piano, a-t-il finalement pu opter pour un choix contraire ? Et le pasteur d’analyser : « je pense que l’orgue était le principal moyen de se démarquer des groupes évangéliques ». Devenu symbole, l’instrument est intouchable. Il s’est érigé en marqueur identitaire, coupant court à toute possibilité de renouvellement. Il ne peut ni disparaître ni se transformer en piano. Il s’est vitrifié à la manière dont une résine végétale, qui jadis irriguait un arbre, s’est figée à jamais en un cristal d’ambre certes esthétique, mais privé de vie.
Le culte des morts-vivants
Je m’interroge alors sur la façon dont des pans entiers du protestantisme réformé se sont zombifiés et conditionnent des pratiques et des rituels qui ne sont plus habités du désir, du sens et de la joie. Une conversation avec de jeunes stagiaires diacres et pasteurs, en formation de communication, m’en donne un indice supplémentaire. Une jeune femme prend la parole pour exprimer les choix qu’elle fait en termes de priorités de communication paroissiale. Elle déclare alors, sans l’ombre d’une hésitation : « Je ne vois pas qui je pourrais inviter à un culte. Je ne connais personne qui viendrait avec plaisir ». À ses yeux, le culte s’est solidifié en un rituel hermétique destiné aux seuls initiés. Elle n’en retire aucun plaisir personnel et ses formes ne rejoignent pas sa culture. Comment pourra-t-elle l’habiter une fois en poste ?
Combien de professionnels et de bénévoles de l’Église se sont-ils sclérosés dans des activités auxquelles ils n’ont plus de flamme à donner ? Combien de Conseils ont-ils figé une activité, une façon de faire, bloqué des initiatives, avec comme principal argument celui de la loyauté à un passé révolu. Combien de célébrations, amidonnées dans leurs oripeaux, qui ont perdu l’âme et l’étincelle ? Combien de rencontres de catéchisme dont le principal effet est celui de refouler des jeunes en leur permettant de comprendre que l’Église n’est pas faite pour eux ? Combien de décisions prises avant tout pour honorer un passé idéalisé, pour valoriser des loyautés réelles ou supposées ou encore pour respecter d’illustres prédécesseurs ? Combien de programmes calqués sur ceux des années précédentes ?
Le syndrome d’impuissance
J’imagine déjà les sentiments d’indignation, de contestation ou de révolte qui pourraient habiter certains lecteurs de ces lignes. Mon propos n’est pas de blesser, mais de questionner. Car oui, on a vite fait de chercher des coupables, fustigeant les professionnels de leur manque de créativité, les Conseils de leur conservatisme, le synode de ses mécanismes de blocage ou les autorités de leur absence de vision. A mon sens, le problème est plus profond. Il a aussi maille à partir avec la complexité des structures, la multiplication des règlements et la lenteur concomitante aux processus démocratiques. Peut-être même que les attentes contradictoires du « grand public » à l’égard du religieux sont-elles déjà assimilées de la part d’un certain nombre d’acteurs.
La colère qui surgit peut-être à la lecture de ces lignes est encore une énergie de combat. A ce titre elle est porteuse de vie à condition qu’elle ne personnalise pas trop ses élans et qu’elle ne cultive pas sa rancœur. Ce qui me préoccupe davantage, c’est la torpeur, la lassitude, la lenteur voire la paralysie. Dans les années 1970, le psychologue américain Martin Seligman a mis en évidence ce qu’il nomme le syndrome de l’impuissance acquise (ou apprise). Cette forme de résignation ou de passivité résulte d’un sentiment d’impossibilité chronique à faire changer les choses. Elle pèse fortement sur la motivation et conduit le sujet à perdre tout espoir en sa capacité de prendre en main son sort. Y aurait-il des formes collectives de cette pathologie ?
Noël, c’est la chasse aux zombies
Il n’est pas simple de résister aux forces de l'inframonde zombiaque. Je ne vois que deux issues possibles. La vie ou la mort. Pour le dire autrement, le maintien d’un statu quo me semble être la pire des solutions. Il ne peut conduire qu’à une pétrification complète et à une lente et inexorable agonie. Je ne vois pas d’autre issue qu’un courage bien trempé qui sache manier ensemble realpolitik et pugnacité. Les protestants réformés ne manquent pas de se souvenir régulièrement de la devise du semper reformanda[1] popularisée par le théologien suisse Karl Barth au milieu du XXe siècle. Mais à trop l’évoquer, elle sonne aussi creux qu’un mantra prononcé sans respirer. Le protestantisme a toujours considéré qu’une critique de l’Église était possible, voire nécessaire. Calvin déjà estime que l’abrogation de rites anciens est parfois souhaitable : « […] nous serons prêts à supporter non seulement le changement de telle ou telle pratique, mais même la modification ou l’abandon de celles auxquelles nous sommes habitués »[2]. Pour le réformateur, l’enjeu est que tôt ou tard, un principe même bénéfique peut enfermer l’institution dans une dérive auto-justificatrice. Mais la critique n’est pas une fin en soi. A trop la manier, elle renforce le processus qu’elle prétend dénoncer.
La zombification de l’Église n’est ni inexorable, ni fatalité. Pour reprendre des catégories archi-classiques, elle n’est que passage entre mort et résurrection. Et la période de l’Avent nous invite à explorer le thème de la naissance. J’y vois une opportunité de nous connecter à la Vie, à l’Espérance à l’Ouverture et à un mouvement certes risqué et douloureux, mais oh combien prometteur.
[1] L’Église est sans cesse à re-réformer.
[2] Calvin, Jean (2015) Institution de la religion chrétienne, Aix-en-Provence : Kerygma, Charols : Excelsis. Livre IV, 10, 32. (p. 1136)