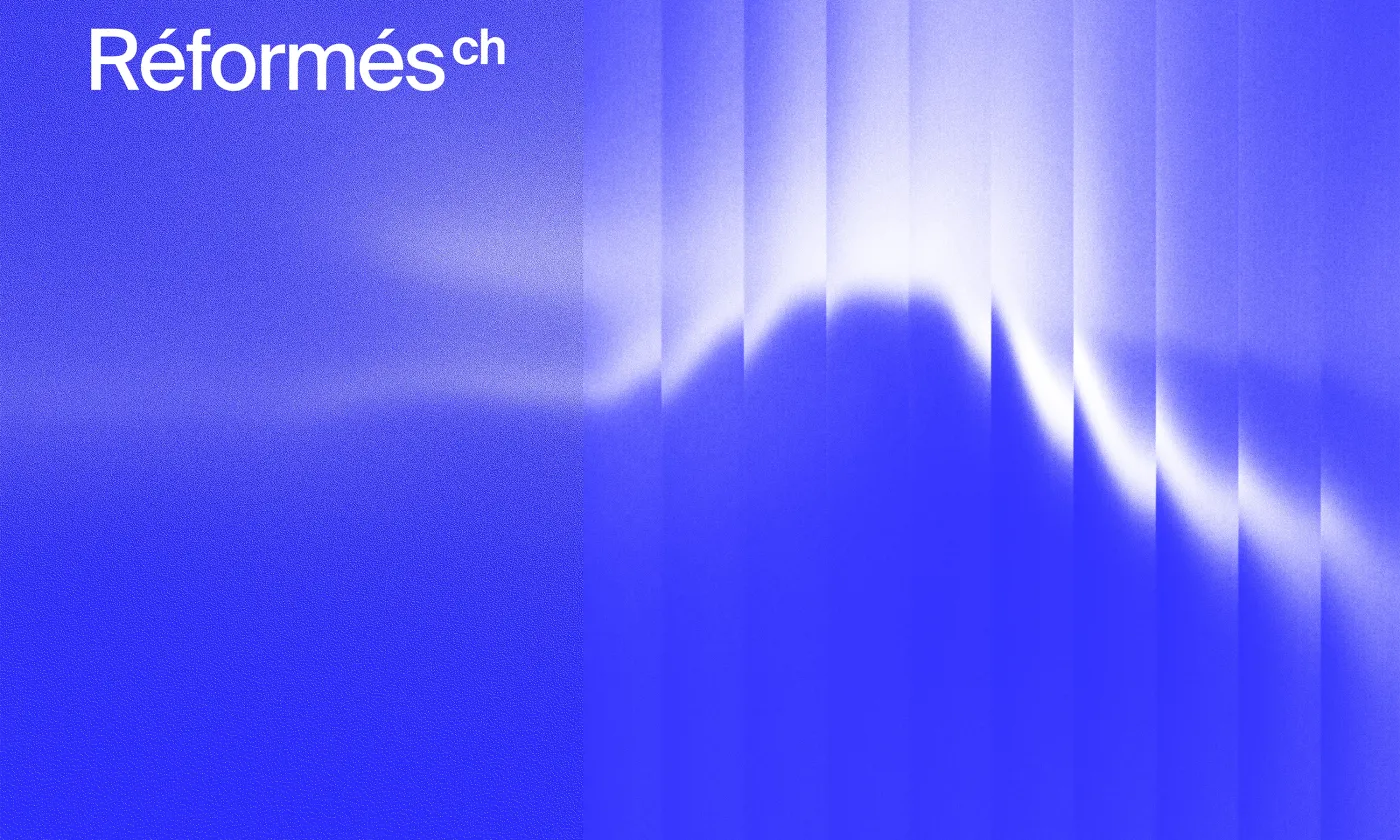
Les mendiants m’énervent
Ils me renvoient quotidiennement à la misère du monde et à mon impuissance face à elle. Si je ne donne pas, si je ne fais rien, je suis mal à l’aise car j’ai de la compassion pour eux. Ce n’est pas une vie digne que celle où vous êtes contraint de tendre un gobelet en plastique, loin de chez vous, dans une ville étrangère, à des gens aux mieux indifférents, au pire hostiles. C’est pitoyable d’en être réduit l’hiver à s’introduire dans un immeuble pour chercher un recoin où se recroqueviller, à même le sol, mais au chaud pour la nuit.
Si je ne leur donne rien, je suis mal à l’aise, mais si je donne, je n’ai rien fait. Et, à chaque fois que je vois un mendiant, je suis renvoyé à ma richesse relative et à mon impuissance. Je ne sais comment concilier la charité chrétienne et la fraternité sociale avec une efficacité nécessaire.
Tartuffe ne voulait pas voir de seins, le monde politique suisse ne veut plus voir de pauvres. Chaque époque a ses obsessions.
Je le vis assez mal ! D’autres, moins portés que moi, peut-être, à la solidarité, le vivent encore plus mal encore et prétendent, à défaut de résoudre le problème que posent ces miséreux, ôter de nos vues l’utile rappel qu’ils sont. La mendicité est interdite dans beaucoup de nos cantons et un projet de loi liberticide, l’interdiction de donner aux mendiants, a germé dans certains esprits, de gauche, paraît-il.
Tartuffe ne voulait pas voir de seins, le monde politique suisse ne veut plus voir de pauvres. Chaque époque a ses obsessions. C’est d’autant plus remarquable que la mendicité est une activité assez largement répandue dans toutes les classes de notre société.
Revenons aux fondamentaux. Mendier, d’après Larousse, c’est « solliciter humblement ou avec
insistance ». J’ajouterai, car cette définition n’est pas complète, que c’est solliciter une faveur ou un avantage sans rien offrir en échange. Si l’on s’en tient à cette définition, beaucoup de gens mendient. Les baisses d’impôts successives exigées, car les mendiants riches haussent volontiers le ton, contraignent nos sociétés policées à serrer la ceinture de leurs pauvres.
Si vous ne baissez pas les impôts, clament leurs défenseurs stipendiés et les fiscalistes de tout poil, les riches iront voir ailleurs. Dans ce cas, nous sommes plus près du chantage que de la mendicité mais le chantage étant un délit, dont je sais très bien que les milliardaires, russes, ousbeks, mexicains ou suédois sont incapables, je préfère en rester à la mendicité.
Le marché est pourtant, de tous les faux Dieux qu’ont inventé les hommes, le plus
sinistrement grotesque. Il est injuste, anarchique, aléatoire, cruel et chaotique, mais son clergé est puissant, souvent bien rétribué, volontiers pontifiant et le bon peuple se laisse subjuguer.
Il y a mieux. Dans nos sociétés néolibérales, l’Etat ne doit pas aider ceux que les folies du Dieu marché ont ruinés. Il faut laisser périr « les canards boiteux » ! proclamait jadis Madame Thatcher. Le marché est pourtant, de tous les faux Dieux qu’ont inventés les hommes, le plus sinistrement grotesque. Il est injuste, anarchique, aléatoire, cruel et chaotique, mais son clergé est puissant, souvent bien rétribué, volontiers pontifiant et le bon peuple se laisse subjuguer.
La fine fleur des économistes et des capitaines de banques et d’industrie est là pour chanter partout et toujours le credo d’un marché salvateur. Et c’est ainsi qu’en Suisse, les ouvriers de l’industrie textile, les fabricants de machines, les horlogers et les petits paysans furent sacrifiés tour à tour ou ensemble sur l’autel du marché. On ne pouvait, on devait rien faire pour eux.
Il advint cependant un jour que l’un des canards favoris des capitaines d’industrie et des banquiers, la Swissair, se mit à boiter. Les directeurs de Swissair se firent humbles et
demandèrent avec insistance un petit milliard pour les sauver. Ils firent mille promesses à leurs sauveteurs potentiels.
Les économistes se divisèrent, les politiciens hésitèrent, mais la loi du marché fut finalement respectée dura lex sed lex, quelques milliers de familles se trouvèrent dans les difficultés extrêmes et la Lufthansa fit l’affaire du siècle. Mais les saints principes économiques avaient été respectés.
Il advint ensuite qu’ayant un peu trop friponné outre Atlantique et ayant, à cause de l’ineptie de ses dirigeants, investi dans des produits douteux tout l’argent qu’elle avait et celui de ses clients, l’UBS, le fleuron de notre système bancaire, se trouva au bord du gouffre. Ce canard boiteux était une grenouille qui s’était voulue plus grosse qu’un diplodocus. Too big to fail.
Ses dirigeants se firent humbles et insistants, renoncèrent à quelques millions de bonus, promirent de s’amender, bref, ils mendièrent. Ils demandaient si peu ! Quelques milliards tout de suite pour boucher un trou grandissant dans les caisses et quelques dizaines de milliards de garantie sans contrepartie pour racheter au besoin les produits toxiques qu’ils avaient eu la bêtise de trafiquer.
Avec ces milliards, elle aurait pu assainir l’AI
La Confédération céda. Avec ces milliards, elle aurait pu assainir l’AI ou acheter des avions de
combat. Non, elle fut charitable, elle donna aux mendiants repentants. Elle sauva l’UBS et notre
Banque nationale est encore encombrée d’actifs toxiques. Avec l’argent ainsi bloqué et
probablement perdu, on aurait pu construire des routes, creuser des tunnels, développer nos
universités et pousser la recherche... La Confédération et la Banque nationale préférèrent donner aux mendiants repentants... et riches.
Deux ans plus tard, revenus à meilleure fortune, l’UBS éponge ses pertes et ne paye pas
d’impôts, mais ses dirigeants ont oublié les promesses qu’une noire nécessité leur avait
arrachées. Ils hurlent leur colère parce que l’on prétend leur imposer des précautions
supplémentaires et réduire leurs profits personnels. Le dénommé Oswald G. explique que la
Suisse est mal gérée et qu’il faut serrer la ceinture de nos concitoyens.
Il parle de porter plainte contre la BNS dont le bilan est encore encombré des actifs toxiques de sa banque. Kaspar V. lui, qui porte le même nom qu’un ancien président de notre Confédération, menace de la délocaliser. Oui, décidément les mendiants riches et arrogants m’énervent. C’est politiquement incorrect, je sais, mais c’est comme ça !
LIRE
Les autres chroniques de M. Le Comte publiées sur le site de ProtestInfo :











